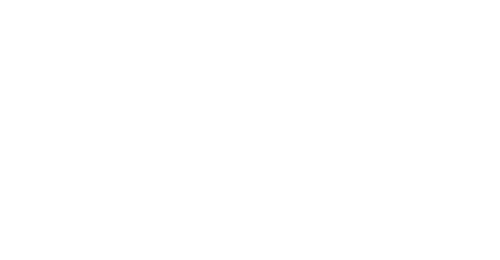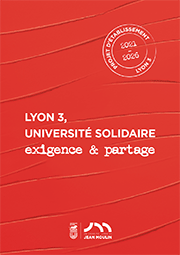Être un prince entre Moyen âge et Renaissance (XIVe-début XVIe siècle) – Réf : H08
Accéder aux sections de la fiche
Call to actions
Nous téléphoner au
+33478787048
Détails
Présentation
Lundi 14h-16h
Attention nouvelle date: À partir du 02/02/2026
Dates de séances prévisionnelles (sous réserve de modification):
02/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03, 20/04, 27/04/2026
Lieu : Campus des quais
Attention nouvelle date: À partir du 02/02/2026
Dates de séances prévisionnelles (sous réserve de modification):
02/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03, 20/04, 27/04/2026
Lieu : Campus des quais
Objectifs
Ce cycle culturel s'adresse à toute personne désireuse de développer ses connaissances, élargir sa culture et approfondir sa réflexion.
Lieux
Lyon
Contacts de la formation
M. François DEMOTZ
Agrégé et docteur en histoire médiévale
Contacts formation continue
FC3 - Service commun de la formation continue et de la professionnalisation
04 78 78 70 48 - universiteculturelle@univ-lyon3.fr
Agrégé et docteur en histoire médiévale
Contacts formation continue
FC3 - Service commun de la formation continue et de la professionnalisation
04 78 78 70 48 - universiteculturelle@univ-lyon3.fr
Admission
Candidature
Conditions d'admission / Modalités de sélection
Accessibles à tout public, sans condition d'âge, ni de diplôme
Inscriptions
Programme
La fin du Moyen-âge, qui est déjà la Renaissance pour les Italiens, est considérée comme le temps des princes. Être un prince, c’est se comporter comme un souverain. Il faut pour cela disposer d’une autorité quasi complète et surtout pratiquer l’imitation du souverain : disposer d’une véritable administration, apparaître en majesté (et donc se soucier de la lèse-majesté), être le centre d’une cour fastueuse, employer des artistes de renom, créer une étiquette, développer sa propre symbolique…
Le tout est incarné par des cérémonies grandioses qui mettent en valeur le prince et sa famille. En cela, les princes de la Renaissance constituent l’aboutissement des princes médiévaux : il faut être à la fois l’arbitre du goût, un chevalier et un lettré, comme l’est toujours François Ier.
Le cours se propose d’explorer toutes ces facettes du prince, en particulier la dimension artistique, à travers des exemples variés aussi bien régionaux, comme les ducs de Bourgogne ou de Savoie, que plus lointains comme les princes italiens et ceux de la cour de France. Si les grands laïcs viennent en premier à l’esprit, le phénomène concerne aussi les grands prélats et les princesses.
On rencontrera donc les grandes figures que sont Jean de Berry et le roi René, mais aussi Anne de Bretagne ou Isabelle d’Este. C’est donner de la fin du Moyen-âge une image très différente d’une période dont on a souvent retenu la peste et la guerre de Cent Ans.
Le tout est incarné par des cérémonies grandioses qui mettent en valeur le prince et sa famille. En cela, les princes de la Renaissance constituent l’aboutissement des princes médiévaux : il faut être à la fois l’arbitre du goût, un chevalier et un lettré, comme l’est toujours François Ier.
Le cours se propose d’explorer toutes ces facettes du prince, en particulier la dimension artistique, à travers des exemples variés aussi bien régionaux, comme les ducs de Bourgogne ou de Savoie, que plus lointains comme les princes italiens et ceux de la cour de France. Si les grands laïcs viennent en premier à l’esprit, le phénomène concerne aussi les grands prélats et les princesses.
On rencontrera donc les grandes figures que sont Jean de Berry et le roi René, mais aussi Anne de Bretagne ou Isabelle d’Este. C’est donner de la fin du Moyen-âge une image très différente d’une période dont on a souvent retenu la peste et la guerre de Cent Ans.
Zoom sur
Mise à jour : 19 janvier 2026