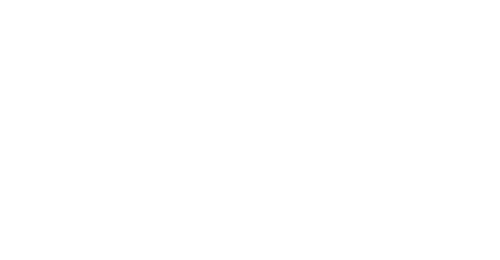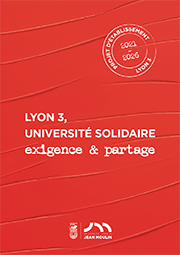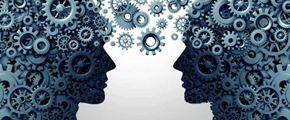AccueilRechercheActualités2007-2008
-
Partager cette page
- Recherche,
Vox Poetae
Publié le 19 novembre 2008 – Mis à jour le 21 novembre 2008
Le colloque "Vox Poetae" a eu lieu les 13 et 14 novembre 2008.

Le colloque des 13 et 14 novembre 2008 intitulé "Vox Poetae : manifestations auctoriales dans l'épopée gréco-latine" qui s'est tenu à l'Université Jean Moulin Lyon 3, dans les locaux du Palais de la Recherche, a tenu toutes ses promesses. Sous l'égide d'Emmanuelle RAYMOND, doctorante en Littérature latine à Lyon 3 et de Bruno BUREAU, professeur de Littérature latine à Lyon 3, les débats ont été tout aussi nombreux que fructueux et intéressants. Ils mettaient en présence des spécialistes d'épopée grecque et latine, réunis sur le sujet des apparitions de la voix du poète dans les oeuvres épiques. La période couverte était extrêmement vaste, allant de la célèbre Iliade d'Homère (fin du VIIIe siècle av. J.-C.) à l'hagiographie aux accents épiques de Venance Fortunat (VIe siècle ap. J.-C.). Par delà la diversité des horizons des interlocuteurs, tous ont réfléchi à la notion de voix poétique, que son absence même des textes anciens -sous la forme consacrée de uox poetae- rendait intéressante à plus d'un titre. Une fois cette rareté du mot -et de la chose- signalée et après qu'eut été rappelée en introduction du colloque la conscience aigüe que les Latins pouvaient avoir des phénomènes de l'implication du poète dans son texte, les interventions ont montré l'étendue des pratiques liées aux manifestations auctoriales. La limite traditionnelle de l'observation des seules modalités énonciatives du genre épique a été repoussée au point de constater que la voix qui dit "je" dans l'épopée, n'est pas seulement affaire de stylistique ou de préciosité, mais que les enjeux des intrusions auctoriales sont d'ordre parfois socio-politique et parfois métapoétique. Plusieurs questions avaient été lancées pour orienter les débats et appelaient des réponses : les manifestations de la uox poetae sont-elles ou non le témoin d'une pratique personnelle ou plutôt d'une pratique générique qui ferait ouvertement fi des principes aristotéliciens sur l'objectivité poétique ? Si la pratique s'avère plus ouvertement générique, quelles sont les variations observables entre l'épopée grecque et l'épopée latine ou encore entre le genre maître, l'épopée, et sa forme réduite, l'epyllion ? Si la pratique en est personnelle en revanche, certains recoupements entre plusieurs auteurs épiques sont-ils envisageables ? Quelle est la tendance générale au sein de chaque œuvre ? Le poète fait-il davantage droit à l'unité de la voix poétique ou faut-il davantage relever dans les textes anciens un éclatement et une diffraction de la voix poétique qui rendraient délicate la perception de l'ego de l'auctor ?
La pérennité des études homériques ne s'est pas démentie lors du colloque : dans une analyse qui portait sur l'adjectif nêpios dans l'Iliade et l'Odyssée, Michel BRIAND (Pr. à l'Université de Poitiers) a tenté de démontrer l'ambivalence de cette intrusion qui aboutit à une différenciation des deux épopées homériques. Intuition qui a été confirmée et développée par l'intervention de Sylvie PERCEAU (MC à l'université d'Amiens) qui, en portant son attention aux intrusions du "nous" dans l'épopée homérique, a bien démontré la différence de statut de la voix du poète de l'Iliade à l'Odyssée. Dans une perspective linguistique, Sandrine DUBEL (MC à l'université de Clermont Ferrand) a cherché à définir les adresses au narrataire et les apostrophes aux personnages chez Homère comme une forme de métalepse dont l'existence au sein d'un genre relevant de l'oralité pouvait paraître paradoxale. Jocelyne PEIGNEY (Pr. à l'université de Tours) s'appuyant sur le chant XVI de l'Iliade, a mis en lumière les enjeux de l'apparition de la voix aédique au sein de l'épisode de la Patroclie. Enfin, Christophe CUSSET (Pr. à l'ENS-LSH de Lyon) et sa doctorante Fanny LEVIN, ont proposé une communication à deux voix sur la voix du poète dans le corpus Theocriteum, revenant ainsi sur la question essentielle de la construction de la figure du poète à travers son œuvre.
L'épopée latine n'a pas été en reste. Martin DINTER (Pr. au King's College de Londres) a ainsi évoqué la présence de "sentences" dans l'Enéide de Virgile dont il a pu souligner le caractère à la fois insaisissable (puisque la sententia n'est pas clairement définie dans les traités de rhétorique antique) mais pourtant très repérable dans le texte. Il a rapproché ces "sentences" de la construction d'une uox Vergilii dont Damien NELIS (Pr. à l'université de Genève) a pu dire qu'elle exerçait un contrôle extrêmement ferme sur son œuvre. Cette affirmation de l'auctorialité virgilienne a été confirmée par Séverine CLEMENT-TARANTINO (agrégée répétitrice à l'ENS-LSH de Lyon) qui a apporté aux réflexions des intervenants précédents le soutien de l'autorité des lecteurs antiques de l'Enéide en revenant sur la conception de la uox poetae qui surgissait à travers les scholies homériques et à travers les commentaires de Servius et de Tiberius Claudius Donatus à l'Enéide.
Dans la lignée des interventions sur Virgile, Aline ESTEVES (MC à l'université Montpellier 3) a mis en rapport les épithètes subjectives et le regard de la voix du poète sur la matière de Troie reprise dans l'Enéide de Virgile et dans le Bellum ciuile de Lucain.
Sur Lucain précisément, Bruno BUREAU (Pr. à l'université Lyon 3) a éclairé d'un jour nouveau les débats sur la présence de la voix poétique dans l'œuvre de Lucain, dont la diffraction et l'éclatement étaient souvent évoqués par la critique ; grâce à une étude des occurrences du "je" puis du "nous" dans la Pharsale, il a montré comment la voix poétique lucanienne s'affirmait non pas tant comme une voix du poète mais une voix-poétesse qui se trouve dans une situation de porte à faux permanent par rapport au code générique dominant qui constitue le texte. C'est également dans une perspective générique que Florence KLEIN (doctorante - ATER à l'université Lille 3) a mis en lumière le positionnement auctorial d'Ovide dans ses Métamorphoses par rapport à la polémique du prologue des Aitia et au refus callimachéen du long poème continu, l'en aeisma dienekès. Les réflexions de Marie LEDENTU (MC à l'université Lyon 3) qui travaillait sur ce même texte, sont venues compléter les analyses de F. KLEIN, grâce au repérage systématique et à la classification des interventions du poète dans les livres XIII à XV des Métamorphoses.
Seuls représentants de l'épopée flavienne, Stace et sa Thébaïde ont été étudiés par Sylvie FRANCHET D'ESPEREY (Pr. à l'université Paris 4) qui, dans la lignée de ce qui a été dit sur Lucain, a évoqué une uox poetae qui se présente en réaction face à la thématique des guerres civiles et de la violence renouvelée. Si nombre de communications ont mis l'accent sur les rapports entre la voix du poète et les thèmes abordés dans l'œuvre, axant ainsi leur réflexion sur le sens et l'interprétation du poème épique, d'autres ont fondé leur intervention sur l'inscription de la voix du poète dans un contexte historique et politique, à l'instar de Marie-France GINESTE (MC à l'université de Haute-Alsace) qui a parlé des modalités et de la signification de la uox poetae dans le De Bello Getico de Claudien, ou de Benjamin GOLDLUST (ATER à l'université Bordeaux 3) qui a pu rapprocher les intrusions auctoriales d'un discours politique à intention panégyrique dans la Johannide de Corippe, ou encore de Lionel MARY (MC à l'université Paris 10) qui a évoqué la question de l'écriture d'une épopée dans un monde où la christianisation a opéré un changement radical d'univers référentiel qui modifie considérablement le statut même de la parole épique.
Pour finir, deux communications ont eu pour objet le genre de l'epyllion affilié à l'épopée : si Emilia NDIAYE (MC à l'université d'Orléans) et Jean-Pierre DE GIORGIO (MC à l'université de Clermont-Ferrand) ont tenté de définir ce qui se présente dans le carmen 64 de Catulle comme une uox poetae noui, Etienne WOLFF (Pr. à l'université Paris 10) a évoqué les marques discrètes d'interventions auctoriales dans les epyllia de Dracontius.
Les questions soulevées par les interventions ont été nombreuses ainsi que les recoupements subséquents entre plusieurs auteurs et plusieurs pratiques. Le colloque des 13 et 14 novembre donnera naissance à des actes pour lesquels nous envisageons une publication à la fin de l'année 2009 et qui rassembleront les communications présentées à l'oral ainsi qu'un article d'Emmanuelle RAYMOND (doctorante à l'université Lyon 3) sur l'adjectif infelix dans l'Enéide de Virgile et son implication dans l'élaboration d'une figure du poète qui paraît pouvoir s'inscrire dans une perspective non plus seulement morale et pathétique, mais aussi diégétique, poétique et même métapoétique.
L'ambition qui est la nôtre n'est pas d'éditer de simples actes qui reprendraient dans l'ordre les interventions des participants, mais il s'agit pour nous de publier une véritable synthèse de la questions des manifestations auctoriales dans l'épopée latine, un livre qui rendrait compte par la diversité des participations et l'étendue de l'espace-temps convoqué, à la fois de l'immense complexité de la question, de son évolution à travers les âges et au gré des œuvres et de la difficulté qu'il peut y avoir à dessiner les contours d'une uox poetae sans une vision d'ensemble des phénomènes d'intrusions auctoriales.
Emmanuelle RAYMOND, doctorante en Littérature latine à l'Université Lyon 3
Bruno BUREAU, Professeur de Littérature latine à l'Université Lyon 3 et directeur du CEROR.
Mise à jour : 21 novembre 2008