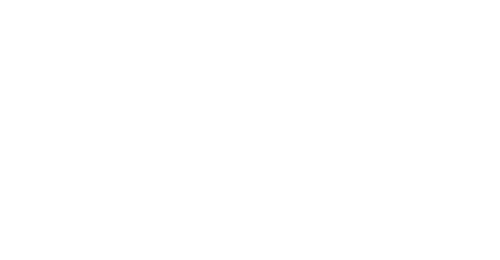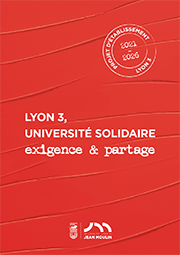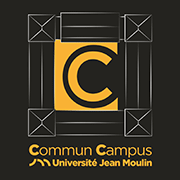AccueilRechercheProgrammes et productions scientifiquesThèsesThèses soutenuesThèses soutenues - 2025
-
Partager cette page
- Recherche,
- Lettres,
TAKAYASU Riho
Philippe Quinault, le poète de la surprise
Thèse en Lettres, soutenue le 16/06/2025.
Le but poursuivi par notre étude est de montrer comment Quinault, mû par la volonté de séduire le spectateur, a délibérément centré sa dramaturgie sur la surprise, ce qui explique la réussite de ses pièces à son époque. Cette stratégie poétique a été négligée jusqu’à maintenant dans les recherches qui le concernent, peut-être parce qu’elles ont trop tendance à découpler sa carrière de dramaturge et celle de librettiste. Or elles sont inséparables et c’est en les rapprochant qu’il est possible de dégager la singularité de la dramaturgie de Quinault. Nous examinons donc l’importance et les modalités de la surprise dans l’œuvre de Quinault, ses pièces parlées comme ses pièces chantées, à l’époque où la surprise, strictement associée à la vraisemblance, est supposée constituer une notion fondamentale des arts représentatifs. En effet, toute la réflexion qui s’est développée à cette époque autour de la surprise permet à Quinault de constituer sa poétique sur une base établie. Il s’adapte à la tendance du monde littéraire et théâtral mais il le fait avec un souci d’originalité qui lui est propre. La surprise est ainsi examinée dans chaque pièce sur les plans matériel, langagier et structurel. Les effets visuels issus des costumes, décors, lumières et mouvements des personnages sont souvent combinés à des effets auditifs, comme l’utilisation de la musique dans les pièces parlées ou les changements de rythme dans les répliques, redoublant ainsi l’efficacité et le plaisir de la surprise. Quant à la création des personnages, Quinault exploite les normes classiques comme sources de surprises, en se fondant sur les mœurs codifiées par les théoriciens. Au niveau des intrigues, il suscite l’attente des surprises chez les spectateurs en les leur laissant prévoir, sans en rien dévoiler. Les péripéties et les coups de théâtre sont conçus pour étonner mais aussi maintenus dans des relations de nécessité au service de l’intrigue. En outre, ces éléments constitutifs de la surprise entrent dans des chaînes d’échos qui lient les pièces de Quinault entre elles ou avec d’autres. L’analyse de la surprise dépend de la prise en compte de cette inter- ou intra-textualité. La récurrence des idées et des procédés dans les répliques peut faire lien entre les différentes pièces et amuser le spectateur surpris de reconnaître des reprises ou des modulations. La surprise devient ainsi un moyen pour le dramaturge de communiquer avec la salle. Car Quinault trouve la source de ses surprises dans les expériences et les connaissances des spectateurs dont il pique la curiosité afin de les solliciter davantage au moment de la représentation. De même, Quinault renouvelle dans ses pièces parlées et chantées le traitement des sources historiques et mythologiques : les évènements connus y sont revivifiés à travers le prisme des passions humaines plus vraisemblables, finalement, que les récits des historiens. Cette façon qu’a Quinault de faire des spectateurs les témoins d’évènements merveilleux, mais inscrits dans des logiques passionnelles particulièrement débattues en cette fin du XVIIe siècle, efface la frontière entre le monde contemporain du public et le monde merveilleux représenté. Quinault expérimente ainsi toutes les sortes de surprise répertoriées comme des éléments essentiels pour la conception d’une œuvre poétique réussie. Mais le soin qu’il prend pour assurer la bonne réception de ses pièces par le public élève la surprise à une nouvelle dimension, que les théoriciens n’avaient pas envisagée. Si la réflexion du dramaturge n’est jamais véritablement déclarée, sa pratique de la surprise structure en effet son théâtre, définit ses enjeux et nourrit sa poésie. Elle contribue fondamentalement à faire de chaque pièce un spectacle total, constamment pensé, pour lequel sont convoquées les ressources de la théâtralité. La surprise est ainsi au centre de l’hommage que Quinault entend rendre au pouvoir du théâtre.
Mots-clés : Quinault ; Théâtre ; Surprise ; XVIIe siècle ; Poétique ; Merveilleux ; Opéra ; Étonnement ; Attente ; Galant ; Littérature ; Métathéâtral ; Vraisemblance ; Rebondissement ; Coup de théâtre ; Passions
The aim of this study is to show how Quinault, driven by a desire to captivate the spectator, deliberately centered his dramaturgy around surprise. This approach helps explain the success of his plays during his lifetime. His poetic strategy has been largely overlooked in studies about him, perhaps because scholars have often treated his work as a playwright and his work as a librettist as two separate careers. Yet these aspects are inseparable, and it is only by examining them together that we can understand the uniqueness of Quinault’s dramaturgy. We therefore explore the significance and mechanics of surprise in both his spoken and sung works, at a time when it was closely linked to the principle of verisimilitude and considered a central concept in the representational arts. The theoretical reflections on surprise that emerged during this period provided Quinault with a solid foundation for constructing his poetics. He followed contemporary literary and theatrical trends while maintaining a strong sense of originality. Surprise is analyzed in each play through its material, linguistic, and structural dimensions. Visual effects created by costumes, sets, lighting, and character movements are often combined with auditory elements, such as music in spoken plays or changes in rhythm within dialogue. These techniques amplify both the impact and enjoyment of the surprise. In developing his characters, Quinault uses classical norms as sources of innovation, drawing from conventions outlined by theorists of the time. Regarding plot structure, Quinault builds anticipation by allowing the audience to sense upcoming twists without ever fully revealing them. These dramatic turns are not only meant to astonish but also serve the internal logic of the story. Moments of surprise often echo across his works, creating connections between plays and even with texts by other authors. Understanding these effects requires attention to both intertextual and intratextual references. Recurring ideas and techniques in the dialogue create links across his oeuvre and offer a playful recognition for spectators familiar with his style. Through this, surprise becomes a genuine form of communication between playwright and audience. Quinault draws on the spectators’ knowledge and experience, stimulating their curiosity and engaging them more deeply during performances. Similarly, in both his spoken and sung plays, he revitalizes historical and mythological material. Well-known events are reinterpreted through the lens of human passion, often making them more believable than the accounts offered by historians. By portraying marvellous events grounded in passional logic, as debated at the end of the 17th century, Quinault makes the audience into witnesses to these events, thereby blurring the boundary between their contemporary reality and the fictional world represented on stage. Quinault experiments with all forms of surprise that were then considered essential to creating a successful poetic work. His careful attention to how his plays would be received elevates audience’s surprise to a dimension unforeseen by earlier theorists. Although Quinault never explicitly articulates a theoretical stance, the way he uses the element of surprise clearly shapes his theatre, defines its meaning, and enriches its poetic quality. It plays a fundamental role in making each of his plays a total spectacle, carefully conceived and made to draw from the full range of theatrical resources. In sum, surprise lies at the core of Quinault’s tribute to the enduring power of theatre.
Keywords: Quinault ; Theatre ; Surprise ; 17th century ; Poetics ; Marvellous ; Opera ; Astonishment ; Expectation ; Gallant ; Literature ; Metatheatrical ; Verisimilitude ; Twist ; Coup de théâtre (dramatic twist); Passions
Direction de thèse : M. Olivier LEPLATRE et Mme Odile DUSSUD
Membres du jury :
- M. Olivier LEPLATRE, Professeur des universités, Université Jean Moulin Lyon 3 - Directeur de thèse
- Mme Odile DUSSUD, Professeure, Université Waseda, Tokyo, Japon - Co-directrice de thèse
- M. Michael DESPREZ, Professeur, Université Sophia, Tokyo, Japon - Rapporteur
- M. Sylvain CORNIC, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3 - Examinateur
- Mme Nobuko AKIYAMA, Professeure, Université Aoyama-Gakuin, Tokyo, Japon
- Mme Kana HATAKEYAMA, Maîtresse de conférences, Université des jeunes filles Shirayuri - Examinatrice
- Mme Sakurako INOUE, Professeure, Université Waseda - Examinatrice
- Mme Carine BARBAFIERI, Professeure des universités, Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes, France, Rapporteure et présidente
Présidence du jury : Mme BARBAFIERI Carine