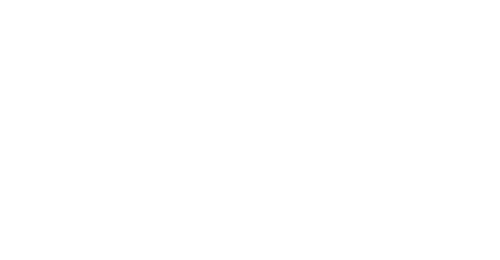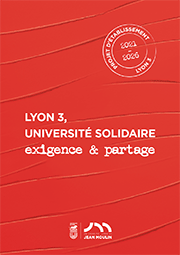AccueilRechercheProgrammes et productions scientifiquesThèsesThèses soutenuesThèses soutenues - 2025
-
Partager cette page
- Recherche,
- Droit,
OLIVIER Sophie
Les enjeux de l'asile face à la sécurité : la situation des individus en besoin de protection représentant une menace pour la sécurité
Thèse en Droit, soutenue le 04/06/2025.
Asile et sécurité apparaissent aujourd’hui étroitement liés au sein des politiques législatives des États occidentaux. L’équilibre à trouver entre, d’une part, la protection des personnes victimes de persécutions et, d’autre part, la sauvegarde de la sécurité se présente comme un enjeu de premier ordre. Et la conciliation s’avère souvent délicate. La Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 consacre une définition universellement partagée du réfugié et rappelle le principe cardinal qui gouverne sa protection : l’obligation, pour l’État qui l’accueille, de ne pas le refouler vers un État sur le territoire duquel il craint pour sa vie ou sa liberté. Si cette obligation est considérée comme la pierre angulaire de la protection des réfugiés, la Convention de Genève l’assortit pourtant d’exceptions au nom de la sauvegarde de la sécurité de l’État d’accueil. Ainsi, un réfugié dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il représente une menace grave pour la sécurité ne pourra pas invoquer le bénéfice du non-refoulement. Cette même mise en tension des impératifs de protection des droits humains et des préoccupations sécuritaires se retrouve dans les différentes règlementations européennes et nationales. Pour ce qui concerne le droit de l’Union européenne, la protection de la sécurité justifie le refus ou l’abrogation du statut de réfugié, entraînant une confusion entre les exceptions au principe de non-refoulement et les clauses d’exclusion et de cessation prévues par la Convention de Genève. Le droit de l’Union européenne prévoit encore d’exclure de la protection subsidiaire l’individu qui représente une menace pour la sécurité. Dans le même temps, les organes de protection des droits humains, notamment la Cour européenne des droits de l’homme, considèrent que rien ne justifie l’éloignement d’une personne vers un État sur le territoire duquel elle court un risque réel d’être exposée à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Les exceptions prévues par le droit de Genève s’en trouvent alors neutralisées. Préoccupés par les menaces qui pourraient être portées à leurs institutions et à leur population, les États tentent d’obtenir un infléchissement de cette solution et, dans l’attente d’un tel revirement, recherchent des alternatives permettant de contourner ou de pallier l’interdiction de l’éloignement. Dans ce contexte, se trouve posée la question des rapports normatifs, complémentaires mais aussi conflictuels, entre les trois niveaux de protection – international, européen et national –, et entre les différentes branches du droit international, notamment le droit de la protection internationale et le droit international des droits humains. Comment, en somme, formuler la juste articulation entre protection de la sécurité et obligation de respecter les droits individuels les plus fondamentaux ? La présente étude entend, d’une part, présenter les différents dispositifs juridiques, particulièrement mouvants, qui régissent la situation des individus en besoin de protection qui représentent une menace pour la sécurité, et d’analyser les conflits normatifs que ces règlementations font émerger. D’autre part, elle entend proposer des solutions permettant de concilier les enjeux en présence, et de garantir tout à la fois la sauvegarde de la sécurité et le respect des obligations internationales de l’État en matière de protection de droits.
Mots-clés : Asile ; Droits humains ; Sécurité ; Réfugiés ; Union euopéenne ; Droit internationale
Immigration and security today appear to be linked in the policies of Western states. Striking a balance between protecting victims of persecution and safeguarding security has become a key issue. The 1951 Refugee Convention enshrines a universal definition of refugees and underscores a cardinal principle: the obligation of the receiving state not to return them to a territory where they fear for their life or freedom. However, the Geneva Convention includes exceptions for the protection of state security. Thus, if there are reasonable grounds to believe that a refugee poses a threat to security, he cannot invoke the principle of non-refoulement. This tension is also reflected in the various European and national regulations. Under European Union law, the protection of security may justify the refusal or withdrawal of refugee status. At the same time, human rights protection bodies, particularly the European Court of Human Rights, maintain that nothing justifies returning individuals to a state where they risk torture or inhuman or degrading treatment. In this context, the question arises of how to reconcile the normative relationships between the three levels of protection—international, European, and national—and the various branches of international law, notably international refugee law and international human rights law. The challenge lies in reconciling the protection of security with the obligation to respect fundamental individual rights. This study aims, firstly, to present the various legal frameworks that govern the situation of individuals in need of protection who pose a threat to security, and to analyze the normative conflicts arising from these regulations. Secondly, it seeks to propose solutions that reconcile the competing priorities at stake, ensuring both the safeguarding of security and compliance with the state’s international obligations.
Keywords: Asylum ; Human rights ; Security ; Refugees ; European union ; International law
Direction de thèse : M. LAVAL Pierre-François
Membres du jury :
- M. Pierre-François LAVAL, Professeur des universités, Université Jean Moulin Lyon 3 - Directeur de thèse
- Mme Catherine GAUTHIER, Professeure des universités, Université de Bordeaux - Rapporteure
- M. Mustapha AFROUKH, Maître de conférences habilité à diriger des recherches, Université de Montpellier - Rapporteur
- M. Olivier DELAS, Professeur, Université Laval, Québec, Canada - Examinateur
- M. Johan ANKRI, Chef de la division des affaires juridiques, européennes et internationales, Office français de protection des réfugiés et apatrides - Examinateur
- Mme Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, Professeure des universités, Université Jean Moulin Lyon 3
Présidence du jury : Mme BASILIEN-GAINCHE Marie-Laure