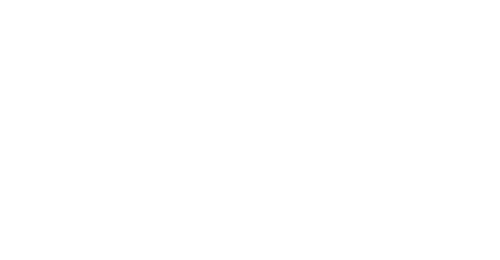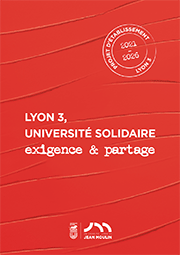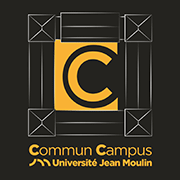AccueilRechercheActualités2007-2008
-
Partager cette page
- Recherche,
Le poète irrévérencieux : modèles hellénistiques et réalité romaines
Publié le 16 novembre 2007 – Mis à jour le 18 mars 2008
Le colloque "Le poète irrévérencieux : modèles hellénistiques et réalités romaines" s'est tenu à Lyon les 19 et 20 octobre 2007.
Le colloque "Le poète irrévérencieux : modèles hellénistiques et réalités romaines" organisé par Bénédicticte DELIGNON (ENS-LSH) et Yves ROMAN (Lyon 2) s'est tenu à Lyon les 19 et 20 octobre 2007.
Les différentes communications proposées durant ce colloque ont d'abord permis de légitimer l'hypothèse d'une irrévérence propre aux poètes, de l'époque classique à l'époque tardive.
Gérard Salamon et Isabelle Cogitore ont ainsi montré qu'à Rome, la prose est d'une certaine manière plus irrévérencieuse que la poésie, la poésie se faisant volontiers l'écho de la mythologie officielle du pouvoir et anticipant sur une libertas déréalisée, une libertas privée de sa nature politique. Dès lors, c'est nécessairement par des voies détournées que le poète se fait irrévérencieux, voies détournées que ce colloque se proposait précisément d'explorer.
Stéphane Benoist a par ailleurs rappelé que le code théodosien encourage à voir davantage de continuité entre l'époque classique et l'époque tardive qu'on ne veut généralement l'admettre, ce qui justifiait pleinement l'élargissement de la problématique du Haut-Empire au Bas-Empire. Les communications ont ainsi proposé des aller-et-retours de l'époque classique à l'époque tardive. Pour l'époque classique, Francesca Rohr Vio a analysé les différentes représentations de Gallus, Séverine Clément-Tarantino s'est intéressée aux possibles implications politiques de la fama épique, Nathan Calonne à la voix du poète dans la Pharsale de Lucain, Etienne Wolff aux ambiguïtés politiques de certaines épigrammes de Martial, Gilles Sauron à la dimension irrévérencieuse de Vénus Erycine dans la poésie augustéenne. Pour la période tardive, Bruno Bureau et Florence Garambois ont montré toute l'ambivalence de l'éloge chez Claudien, et Alexandre Renaud a proposé une double lecture de Sidoine Apollinaire. Or ce sont les mêmes questions et les mêmes conclusions qui ont surgi.
Mais ce colloque a également permis de mesurer la difficulté qu'il y a non seulement à traquer l'irrévérence voilée des poètes, mais même à définir le statut, la fonction et les motivations de cette irrévérence. Ainsi la frontière entre irrévérence et éloge est-elle apparue particulièrement labile. Et en ce sens le détour par la poésie hellénistique s'est avéré très fécond, puisque Evelyne Prioux, Christophe Cusset et Yannick Durbec se sont accordés à reconnaître, chez les poètes alexandrins, une capacité à superposer éloge et irrévérence. Ils ont même montré que l'irrévérence peut plaire à la cour notamment lorsqu'elle choisit les voies de l'humour, propres à séduire un public lettré plein d'esprit. Mais la comparaison s'arrête là. Car si l'irrévérence peut plaire au prince à Rome, c'est moins par ses qualités poétiques que par son intérêt politique : le prince n'aime pas passer pour un tyran et l'irrévérence peut venir cautionner la fiction de la res publica restituta.
La place que le poète accorde à l'irrévérence s'explique par la complexité des rapports qu'il entretient avec le prince et la complexité des rapports que le prince entretient avec la libertas. C'est ce qu'ont très bien montré Isabelle Cogitore, Arnaud Suspène, Stéphane Benoist et Philippe Le Doze. Arnaud Suspène a même proposé l'expression d' " irrévérence de collaboration ", l'irrévérence pouvant finalement répondre à deux motivations quasi-opposées, mais qui ne s'excluent pas : participer à illustrer la ciuilitas du prince ; donner de la valeur et de la célébrité au poète dans certains milieux, notamment dans les milieux de l'opposition. Pour compliquer encore les choses, Stéphane Benoist montré qu'il ne fallait pas s'exagérer la dangerosité de l'irrévérence, puisqu'il n'y a sans doute pas à Rome de censure au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais plutôt une manifestation publique d'affirmation d'un pouvoir, une mise en scène de la capacité à contrôler la parole. Ce qui ne signifie pas bien sûr que les voies détournées par lesquelles le poète se fait irrévérencieux sont inutiles : elles permettent de maintenir le précaire équilibre entre respect affiché et libertas de bon ton, et elles mettent le poète à l'abri, car le prince n'en demeure pas moins imprévisible.
Mise à jour : 18 mars 2008