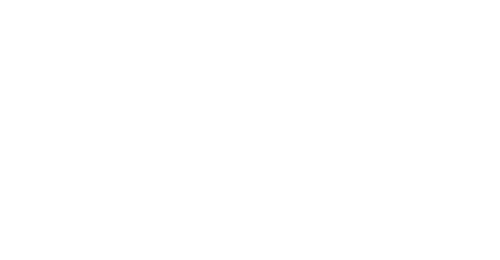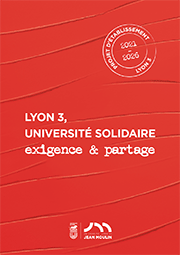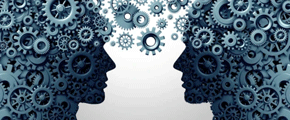AccueilRechercheProgrammes et productions scientifiquesThèsesThèses soutenuesThèses soutenues - 2025
-
Partager cette page
- Recherche,
- Philosophie,
DE BOYER DES ROCHES Luc-Etienne
La nature du rire chez Kant : analyse, genèse et portée de l’approche physiologique du rire au sein de la philosophie kantienne
Thèse en Philosophie, soutenue le 06/06/2025.
L'apparition de la perspective linéaire à la Renaissance a eu un immense impact sur le développement de l'art occidental. Bien que l'art moderne ait remis en question la perspective linéaire, le mode de représentation de l'espace reste aujourd'hui, à l'échelle mondiale, défini par un espace tridimensionnel basé sur les axes x, y et z, que ce soit dans la planification urbaine et la conception de paysages assistées par ordinateur, ou encore dans le design artistique de films et de jeux vidéo. L'hégémonie de ce système limite notre perception et notre compréhension d'autres modes spatiaux. Dans ce contexte, la réflexion contemporaine sur la perspective linéaire demeure pertinente. Dans le domaine théorique, l'article de l'historien de l'art Erwin Panofsky intitulé La Perspective comme forme symbolique (1924-1925) a initié des débats sur la perspective, au XXe siècle, soulevant des questions autour de la notion de forme symbolique, de perspective curviligne, de perception naturelle et de l'histoire de la perspective. Parmi ces questions spécifiques : la perspective linéaire correspond-elle à notre perception naturelle ? Est-elle le seul moyen pour l'artiste de représenter fidèlement le monde ? Quelle est la relation entre la perspective linéaire et d'autres méthodes picturales ? Après Panofsky, de nombreux chercheurs tels que John White, Pierre Francastel, André Chastel, Liliane Brion-Guerry, Ernst Gombrich, et Hubert Damisch ont également participé à ces débats, créant ainsi un riche contexte de discussions théoriques. En tant que l'un des premiers chercheurs français à avoir lu l'article, Merleau-Ponty fait directement référence ou commente les recherches de Panofsky dans plusieurs textes, y compris lors du cours intitulé « L'expérience d'autrui » donné à la Sorbonne entre 1951 et 1952, celui intitulé « L'institution dans l'histoire personnelle et publique » enseigné au Collège de France en 1954-1955, et dans son dernier texte L'œil et l'esprit. Ses réflexions sur la perception, l'expression artistique, la nature, la culture et l'histoire nous offrent un nouvel éclairage pour appréhender la perspective linéaire. Ainsi, il est légitime d'inclure ce penseur français dans les discussions théoriques susmentionnées, et de considérer comment ces questions sont traitées dans sa pensée. Plus précisément, cette étude analysera, d'une part, ses dialogues théoriques, directs ou implicites, avec d'autres théoriciens (en particulier Panofsky, Francastel, Damisch, Gombrich) et, d'autre part, si l'on pense avec Merleau-Ponty, comment certains problèmes spécifiques (comme la déformation de perspective chez Cézanne, la perspective dans les dessins d'enfants, la perspective sphérique de Léonard de Vinci, la perspective naturelle dans l'Académie royale de peinture et de sculpture du XVIIe siècle, ainsi que la « perspective » dans la peinture chinoise) sont abordés. La présente étude a pour objet de démontrer que, bien que Merleau-Ponty ait commis certaines erreurs sur des détails relatifs à l'histoire de l'art et qu'il manifeste « une oscillation » (Mauro Carbone) concernant la relation entre l'expression et la perception, il montre néanmoins clairement que la perspective linéaire est une création artistique propre à un contexte historique et culturel spécifique. À travers cette dernière et toutes les autres expressions apparues et à venir, la nature se présente dans toute sa profondeur. En même temps, l'examen de cette technique de peinture spécifique nous conduit également à découvrir que Merleau-Ponty décrit, avec le terme « système de perspectives », une nouvelle forme de perspectivisme transculturel et transhistorique, où les différents points de vue sont entrelacés et toujours ouverts. Les réflexions de Merleau-Ponty nous apportent ainsi une ouverture pour comprendre les visions de l'espace dans différents contextes culturels et historiques, et nous motivent à expérimenter et à créer de nouvelles expériences spatiales aujourd'hui.
Mots-clés : Kant ; Rire ; Physiologie ; Histoire de la physiologie ; Physique ; Esthétique ; Psychologie ; Morale ; Pragmatique ; Santé ; Plaisir ; Joie ; Comique ; Humour ; Witz ; Geist ; Laune ; Baumgarten ; Meier ; Haller
This thesis proposes a study of Kant's physiology of laughter, with the aim of providing an account of its genesis and development. In so doing, it also proposes a study of Kant's relationship to physiology in general, and to human physiology in particular. The first part is devoted to the anatomical aspects of the physiology of laughter. The first chapter serves as an introduction, setting out the ambiguity of Kant's anatomical details on laughter, and reviewing our historical and philosophical approach. Chapter II presents elements of anatomical-moral physiology borrowed from precritical texts (these elements concern the Kantian approach to physiology in general, not the physiology of laughter, but this chapter is also a first opportunity to see Kant think or practice laughter in philosophy). Chapter III returns to Kant's physiology of laughter and proposes an understanding of its meaning within the critical system, based on a comparison of critical physiological thought with its sources. The second part consists of chapter IV alone, and offers a brief history of the anatomical and physiological approaches to laughter (based on Kantian principles of such a history of physiological science). The aim of this historical section is to show how Kant's ideas converged with the physiology of his time. Ultimately, we see Kant's convergence with the medical treatises of his time. The third part examines what we have termed the first physiological doctrine of laughter. Chapter VI presents the first Kantian physiology in its general forms, as a physiology modelled on physics. It provides an opportunity to study Kant's pre-critical anthropology, which seems to draw on the sources of his physics and the psychology of Baumgarten and Meier, but also to show elements of the psychology of laughter which, in these pre-critical texts, foreshadow the critical doctrine. Chapter VII proposes to reconstruct the (precritical) physico-moral doctrine of laughter on the basis of the Observations on the Sentiment of the Beautiful and the Sublime and a number of other pre-critical texts. This exposition examines the therapeutic, aesthetic and moral dimensions of laughter, always in dialogue with the psychology of Baumgarten and Meier, and always under the influence of the physics model. These elements make it possible to reconstruct the first physico-moral and precritical doctrine, which is a natural doctrine of laughter. Part Four examines the critical physiology of laughter. From an empirical point of view, this critical doctrine of laughter resembles a reworking of the natural, precritical doctrine. But in the meantime, Kant has revolutionized his philosophy: his physiology and anthropology are no longer modelled on his physics, but on the development of critical philosophy. As a result, the physiology of laughter has become more precise. Chapter VII examines the content of this physiology. First, the psychological elements involved in laughter (since the anatomical elements were studied in the first part). In particular, it examines the breaks with precritical physiology and psychology (especially around the notions of Geist and Witz). Next, the relationship of these psychological faculties to the funny, the comic and humor (Laune or Launichte Manier) is examined. Finally, the last section of the chapter looks at how the mind and people experience laughter as a pleasurable and health-giving affect. Chapter VII shows how the physiology of laughter itself feeds into practical and pragmatic considerations. This is particularly true of joking and mockery.
Keywords: Kant; Laughter; Physiology; History of physiology; Physics; Aesthetics; Psychology; Morality; Pragmatics; Health; Pleasure; Joy; Comedy; Humor; Witz; Geist; Laune; Baumgarten; Meier; Haller
Direction de thèse : Mme LEQUAN Mai
Membres du jury :
- Mme Mai LEQUAN, Professeure des universités, Université Jean Moulin Lyon 3, France - Directrice de thèse
- Mme Stefanie BUCHENAU, Professeure des universités, Université Paris 8, France - Rapporteure
- Mme Inga RÖMER, Professeure, Université Albert-Ludwigs Fribourg, Allemagne - Rapporteure
- M. Denis THOUARD, Directeur de recherche, EHESS / CNRS - Centre George Simmel, Paris, France - Examinateur
- M. Giuseppe MOTTA, Maître de conférences, Université de Vienne, Autriche - Examinateur
- M. Laurent JAFFRO, Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France
Présidence du jury : M. JAFFRO Laurent