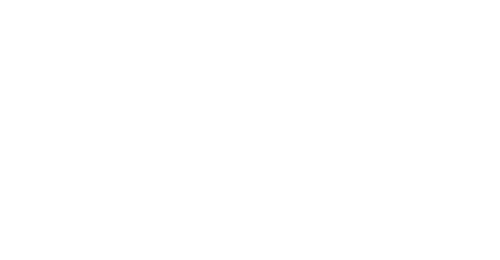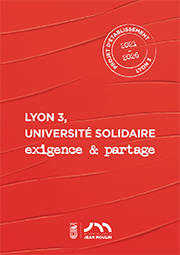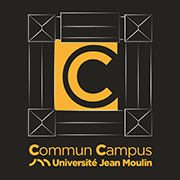22220075 - Institutions politiques
| Niveau de diplôme | |
|---|---|
| Crédits ECTS | 5 |
| Volume horaire total | 24 |
| Volume horaire CM | 24 |
Contenu
Naissance et affirmation de la royauté occidentale médiévale (fin Ve – début XIIe s.)
Au cours du Ve siècle, en Occident, se substituent au gouvernement impérial de Rome des royaumes, dirigés par des rois issus de groupes de population nouvellement installés à l’intérieur de l’empire : les rois « barbares » imposent leur pouvoir alors même que le peuple romain se méfie de la royauté, considérée négativement parce que consacrant le pouvoir d’un seul. Certes, cette idée du pouvoir d’un homme seul s’était progressivement diffusée parmi les citoyens romains avec la dilatation impériale et la crise de l’organisation civique, impropre au gouvernement d’un immense empire : la naissance du principat en 27 avant Jésus-Christ a consacré le pouvoir d’un princeps, premier parmi les citoyens. Mais l’idéal impérial propage l’image d’un empire uni, façonné par la communauté des citoyens.
Au Ve siècle, cet idéal est affaibli par une crise multiforme qui sape les institutions impériales. En s’appuyant sur les structures subsistantes, l’Église apporte son soutien à ces chefs guerriers, d’origine germanique, installés dans l’empire, et accélère la mutation politique en favorisant le transfert de la légitimité de l’empire à ces nouveaux souverains : ainsi naît la royauté médiévale. Le roi s’affirme, « produit d’une rupture et d’une innovation en matière politique » fondées sur des héritages variés, « depuis l’Antiquité, l’Inde et le Moyen Orient à la monarchie hellénistique, depuis l’Ancien Testament jusqu’à l’Empire romain et aux mondes celtique et germanique prémédiévaux » (J. Le Goff, article « roi » du Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval).
Ce cours s’attachera ainsi à étudier la royauté médiévale, construction institutionnelle originale et innovante, caractéristique du Moyen Âge occidental, en observant à la fois ses structures organiques mais également ses fondements sociaux et culturels : en d’autres termes, nous considérerons les rouages des royautés médiévales mais également le terreau politique dans lequel elles s’enracinent, sur une période longue, de la fin du Ve siècle jusqu’au début du XIIe siècle.
Au cours du Ve siècle, en Occident, se substituent au gouvernement impérial de Rome des royaumes, dirigés par des rois issus de groupes de population nouvellement installés à l’intérieur de l’empire : les rois « barbares » imposent leur pouvoir alors même que le peuple romain se méfie de la royauté, considérée négativement parce que consacrant le pouvoir d’un seul. Certes, cette idée du pouvoir d’un homme seul s’était progressivement diffusée parmi les citoyens romains avec la dilatation impériale et la crise de l’organisation civique, impropre au gouvernement d’un immense empire : la naissance du principat en 27 avant Jésus-Christ a consacré le pouvoir d’un princeps, premier parmi les citoyens. Mais l’idéal impérial propage l’image d’un empire uni, façonné par la communauté des citoyens.
Au Ve siècle, cet idéal est affaibli par une crise multiforme qui sape les institutions impériales. En s’appuyant sur les structures subsistantes, l’Église apporte son soutien à ces chefs guerriers, d’origine germanique, installés dans l’empire, et accélère la mutation politique en favorisant le transfert de la légitimité de l’empire à ces nouveaux souverains : ainsi naît la royauté médiévale. Le roi s’affirme, « produit d’une rupture et d’une innovation en matière politique » fondées sur des héritages variés, « depuis l’Antiquité, l’Inde et le Moyen Orient à la monarchie hellénistique, depuis l’Ancien Testament jusqu’à l’Empire romain et aux mondes celtique et germanique prémédiévaux » (J. Le Goff, article « roi » du Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval).
Ce cours s’attachera ainsi à étudier la royauté médiévale, construction institutionnelle originale et innovante, caractéristique du Moyen Âge occidental, en observant à la fois ses structures organiques mais également ses fondements sociaux et culturels : en d’autres termes, nous considérerons les rouages des royautés médiévales mais également le terreau politique dans lequel elles s’enracinent, sur une période longue, de la fin du Ve siècle jusqu’au début du XIIe siècle.
Bibliographie
Orientation bibliographique
- Pour une vue d’ensemble du cadre chronologique : Michel BALARD (et alii), Le Moyen Âge en Occident, Paris, 2011 (5e éd.).
- Pour réfléchir à la question : Jacques LE GOFF, article « Roi », dans J. LE GOFF et J-C. SCHMITT (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, 1999.
- Un ouvrage fondateur : Marc BLOCH, Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre, Paris, 1983 (réédition avec une préface de J. Le Goff de l’ouvrage publié pour la première fois à Strasbourg en 1924 : il faut lire cette préface de J. Le Goff).
Renseignements pratiques
Faculté des Humanités, Lettres et Sociétés
1C, avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 LYON Cedex 08
Sur Internet
1C, avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 LYON Cedex 08
Sur Internet
Mise à jour : 13 septembre 2023