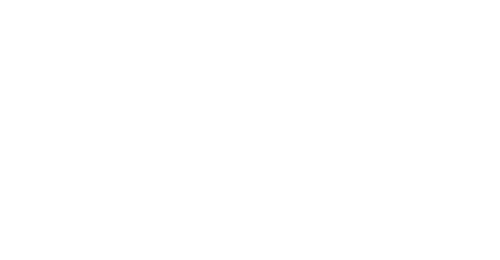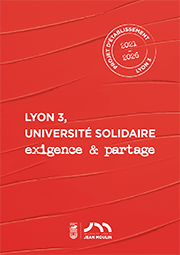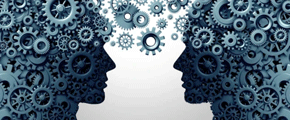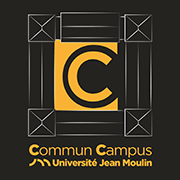Éthique - Philosophie - Esthétique
17200061 - Philosophie ancienne et médiévale
| Niveau de diplôme | |
|---|---|
| Crédits ECTS | 4 |
| Volume horaire total | 18 |
| Volume horaire CM | 18 |
Responsables
Contenu
Licence 3 - Semestre 5 - Mineure Philosophie pour spécialistes et non spécialistes - Année universitaire 2025-26
Enseignante : Clémentine LESSARD
Titre du cours : Aux sources de l’hylémorphisme : Aristote
Programme du cours :
Les notions de forme (morphè, eidos) et de matière (hylè), héritées d’Aristote et communément réunies sous le nom de schème hylémorphique, constituent l’un des cadres les plus durables et les plus généraux de notre pensée : l’art du sculpteur est la mise en forme d’un bloc de glaise, de même qu’en biologie, la croissance suppose la réalisation d’un programme inscrit en puissance dans la matière. L’esprit lui-même a pu être comparé à une cire, sur laquelle s’imprimeraient les formes constitutives de la connaissance. Mais ces notions s’étendent-elles véritablement à tout ? Peut-on faire de l’hylémorphisme un schème universel à portée ontologique ? Tel semble avoir été le geste d’Aristote, qui a pour la première fois conceptualisé matière et forme pour penser la composition des réalités naturelles. Il y trouvait un outil souple, capable de dépasser l’alternative entre le matérialisme des penseurs présocratiques et la théorie des formes de Platon. Comment ce schème permet-il de penser ensemble la nature, la technique, le rapport âme-corps et l’être lui-même ?
De la reproduction sexuée à la fabrication d’une épée, ce cours se propose d’enquêter sur la genèse, les usages et les tensions internes du schème hylémorphique chez Aristote, tout en interrogeant la légitimité et les transformations de son application dans son œuvre, entre physique et métaphysique.
Enseignante : Clémentine LESSARD
Titre du cours : Aux sources de l’hylémorphisme : Aristote
Programme du cours :
Les notions de forme (morphè, eidos) et de matière (hylè), héritées d’Aristote et communément réunies sous le nom de schème hylémorphique, constituent l’un des cadres les plus durables et les plus généraux de notre pensée : l’art du sculpteur est la mise en forme d’un bloc de glaise, de même qu’en biologie, la croissance suppose la réalisation d’un programme inscrit en puissance dans la matière. L’esprit lui-même a pu être comparé à une cire, sur laquelle s’imprimeraient les formes constitutives de la connaissance. Mais ces notions s’étendent-elles véritablement à tout ? Peut-on faire de l’hylémorphisme un schème universel à portée ontologique ? Tel semble avoir été le geste d’Aristote, qui a pour la première fois conceptualisé matière et forme pour penser la composition des réalités naturelles. Il y trouvait un outil souple, capable de dépasser l’alternative entre le matérialisme des penseurs présocratiques et la théorie des formes de Platon. Comment ce schème permet-il de penser ensemble la nature, la technique, le rapport âme-corps et l’être lui-même ?
De la reproduction sexuée à la fabrication d’une épée, ce cours se propose d’enquêter sur la genèse, les usages et les tensions internes du schème hylémorphique chez Aristote, tout en interrogeant la légitimité et les transformations de son application dans son œuvre, entre physique et métaphysique.
Bibliographie
- Aristote, Physique, trad. P. Pellegrin, Paris, GF, 2021.
- Aristote, Métaphysique, trad. M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, GF, 2025.
- Aristote, De l’âme, trad. Richard Bodéüs, Paris, GF, 2018.
- Aristote, Parties des animaux, trad. P. Pellegrin, Paris, GF, 2011.
- Aristote, De la génération et de la corruption, trad. Marwan Rashed, Paris, Belles Lettres, 2005.
Contrôles des connaissances
Terminal écrit (TE) 2h
Formations dont fait partie ce cours
Renseignements pratiques
Faculté de Philosophie
Adresse postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Sur Internet
Adresse postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Sur Internet
Mise à jour : 15 juillet 2025